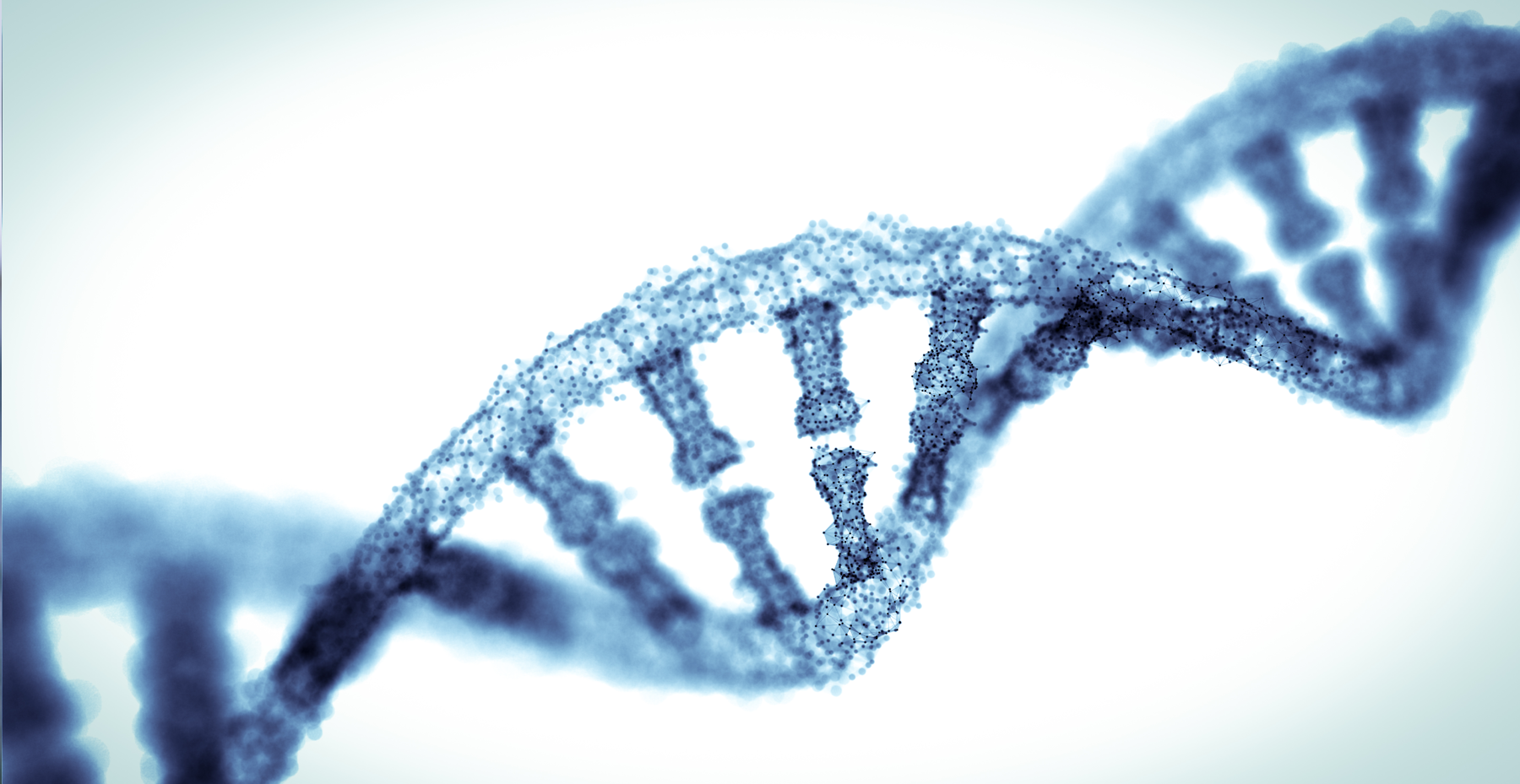Aujourd’hui, c’est encore le médecin qui est au centre des décisions. Cette chaîne décisionnelle va-t-elle se modifier?
C.B. Aujourd’hui, ce n’est pas toujours le médecin qui décide, au vu notamment des choix techniques à opérer à l’hôpital. Il y a souvent un dialogue entre le praticien et l’ingénieur biomédical. Cela dit, je pense qu’il y a là une place pour de nouvelles professions: si on prend le cas des chutes et d’une assistance technologique, on va avoir besoin de redessiner certaines professions pour s’assurer que l’interface se réalise.
O.G. De ce point de vue, je me demande si on ne devrait pas aussi revisiter le travail des spécialistes de l’ergonomie, qui intégreraient cette interconnectivité du point de vue du patient. La qualité de vie de la personne âgée et de ses proches devrait être approchée de manière holistique: l’ergonomie, ce ne sera plus seulement un patient et un dispositif technique, mais un environnement, un écosystème qui intègre d’autres techniques en fonction des besoins. Pensez à la maison connectée: personne ne nous apprend à l’utiliser et tout le monde pense que c’est simple…!
C.B. Comment accompagner l’irruption de nouvelles technologies? Je pense qu’il faut impliquer très en amont les utilisateurs potentiels, patients comme familles. Mais il y a un déficit de ce côté-là actuellement, à toutes les phases du projet, même si cela figure parmi les standards européens. On projette parfois, dans telle ou telle application, le recours au seul smartphone, alors que tout le monde n’est pas capable de l’utiliser ou n’en est pas équipé. L’objet arrive sur le marché, mais reste en décalage par rapport à l’usage, faute de dialogue préalable.
O.G. Dans les efforts d’innovation, il y a toujours un groupe d’utilisateurs, mais on envisage peu l’accompagnement des technologies sur la longue durée. Les aspects triviaux de la vie quotidienne sont considérés comme secondaires. C’est pourtant là que se joueront les succès et les échecs des nouveaux dispositifs.
C.B. En effet, avec une technologie et un financeur dans le projet, personne ne pourra jamais exclure qu’on torde le bras aux pratiques pour que l’application en question soit utilisée quand même!
O.G. En outre, toutes les populations n’ont pas le même pouvoir! Une application pour ados qui ne plaît pas à son public cible disparaîtra le lendemain. Pour des personnes dépendantes, la donne est différente.
Vous soulevez de très nombreux points de discussion relatifs aux nouvelles technologies qui sont en lien avec la qualité de vie ou le vieillissement de la population. Le débat public s’est-il déjà saisi de ce thème, selon vous?
C.B. Non, ce débat n’est pas encore dans les radars. S’il faut se préparer à saisir les opportunités, il faut aussi que le débat, confisqué aujourd’hui par l’industrie, ait du sens et s’ouvre aux questions éthiques notamment. Entre médecins, pour l’heure, nous abordons ces questions selon les opportunités, comme de nouvelles applications, mais jamais au sens générique.
O.G. Si le débat n’existe pas, les premiers objets concrets, eux, débarquent sur le marché: c’est un bon prétexte pour le lancer avec les utilisateurs. Ce qui manque encore, en revanche, c’est une approche systémique: une fois que toutes ces briques vont se connecter et participer à des visions à grande échelle – incluant par exemple d’autres acteurs comme les assurances –, que va-t-il se passer? Je pense que ce débat demande de travailler aussi sur notre propre imaginaire. Nous conceptualisons ce futur à partir de notre expérience du monde contemporain, mais est-ce suffisant pour débattre de l’ampleur des développements envisagés ?
Quel serait votre appel ou recommandation à formuler en guise de conclusion, s’agissant des seniors?
C.B. D’abord, ne jamais oublier l’utilisateur principal du système. Dans nos métiers, on a hélas une tendance naturelle à aller au plus simple, c’est-à-dire la famille ou les proches, par souci d’efficacité. Il faut pourtant remettre l’utilisateur au centre de la réflexion. Même des personnes avec des atteintes cognitives doivent être capables de donner leur point de vue. Au niveau sociétal, maintenant, qui devrait porter ce débat? Les partis politiques, les pouvoirs publics, le milieu académique, les industries? Toutes, je crois. Enfin, je pense qu’on ne doit pas permettre la mise à disposition des nouvelles technologies sans avoir mené une réflexion et une évaluation en termes de risques-bénéfices. Et là, assurément, il faudra le faire de manière indépendante de l’industrie!