La Fondation Leenaards cherche à accompagner les mutations de la société en soutenant des projets et en stimulant des initiatives dans les domaines culturel, âge & société et scientifique, au sein de l’arc lémanique.
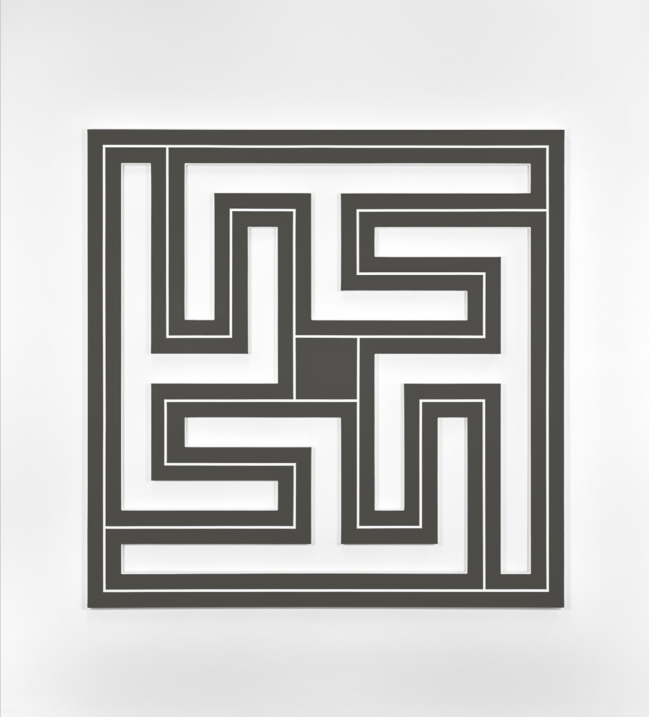
La Fondation Leenaards cherche à accompagner les mutations de la société en soutenant des projets et en stimulant des initiatives dans les domaines culturel, âge & société et scientifique, au sein de l’arc lémanique.
Dans cette édition 2022, nous vous proposons de plonger dans différents Regards, portés par des expert.e.s, artistes et autres penseur.euse.s. A l’invitation de la Fondation Leenaards, ils et elles offrent leurs réflexions personnelles sur des sujets liés aux domaines d’action de la Fondation.
Quand une année s’achève et qu’on en tire le bilan, on peut retenir le pire ou le meilleur. Je choisis le meilleur, tant ma foi en l’être humain est grande. Je crois aussi en sa formidable capacité d’adaptation, d’autant plus importante quand les temps sont durs et incertains.
Que nous a légué 2021 ? Au niveau de la société suisse, deux avancées majeures : le mariage pour tous et l’octroi du congé paternité. En lien avec le Covid, il est à retenir la forte résilience de secteurs d’activité clés pour la cohésion sociale, tels que la santé, la culture ou l’action sociale, doublée d’une formidable solidarité envers les plus vulnérables. En termes de philanthropie, la capacité des fondations comme la nôtre d’ajuster leurs actions aux priorités du moment. Cette agilité repose sur des valeurs fortes d’humanisme, d’engagement et d’ouverture, qui sont l’ADN de la Fondation et plus que jamais indispensables au vivre-ensemble.
C’est forte de cet héritage que je prends la fonction de présidente de la Fondation. Je l’assumerai avec détermination et avec la conviction que la Fondation est, et doit rester, un acteur important de la société civile, qui accompagne les mutations sociales. Il s’agit de donner des impulsions et dynamiques nouvelles pour soutenir la recherche de nouveaux équilibres ; une balance d’autant plus essentielle à trouver en période de crise profonde. Je remercie chaleureusement Pierre-Luc Maillefer pour cette année tellement riche et instructive passée à ses côtés et lui souhaite le meilleur pour la suite de ses engagements.
Brigitte Rorive Feytmans
Présidente dès le 1er mai 2022

Traditionnellement, nos « regards » se portent sur les actions récentes de la Fondation et celles qu’elle s’apprête à réaliser. Cette année, l’actualité m’invite à poser un autre regard sur cet éditorial, celui du présent qui, s’il nous échappe, requiert une pensée solidaire pour les cohortes de réfugiés, de familles séparées et de civils victimes d’une guerre aux marches de l’Europe. Bien sûr, il y va des souffrances du peuple ukrainien, mais aussi de celles d’une population russe dissidente. Il y va aussi des souffrances liées à une migration globalisée, cet autre grand flux de misères du XXIe siècle.
Dans ce contexte bouleversé et bouleversant, la Fondation Leenaards, à la mesure de ses moyens et forte de ses valeurs d’ouverture et d’humanisme, poursuit son action : dans le champ social, par le soutien aux initiatives favorisant le vivre-ensemble et, en particulier, les solidarités locales ; dans le domaine des sciences et de la santé, par sa contribution à une approche intégrative et aussi inclusive de la santé ; sans oublier la culture, où le champ artistique peut – et doit – rester un lieu d’échange et d’enrichissement interculturel.
Que les enjeux soient d’ordre géopolitique, environnemental ou sociétal, la Fondation Leenaards continue et continuera d’accompagner les mutations de notre société, d’autant plus quand il s’agit de bouleversements particulièrement violents à affronter. Sur un plan plus personnel, ceci est mon dernier éditorial, après près de dix années de bonheur passées en tant que président de la Fondation Leenaards. Brigitte Rorive Feytmans, avec qui j’ai eu le grand plaisir de passer cette année de transition, vient en effet d’en reprendre la présidence. Je lui souhaite force, satisfaction et plein succès dans ce rôle passionnant. Et que la Fondation continue à défendre des valeurs humanistes et à croire en un monde meilleur où le vivre-ensemble n’a de cesse de se réinventer et de se déployer.
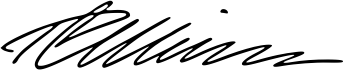
Propos recueillis par
Isabelle Rüf, journaliste littéraire


Isabelle Rüf
Caroline Coutau, reprendre l’important catalogue des Editions Zoé signifiait non seulement le faire vivre, mais aussi lui apporter de nouvelles formes et d’autres voix. Comment cela s’est-il passé ?
Caroline Coutau
Ma chance est d’être arrivée au moment où éclot une nouvelle génération d’écrivaines et écrivains en Suisse romande. Peut- être est-ce dû à l’Institut littéraire de Bienne qui, depuis 2006, forme des auteurs de manière académique ? Et sans nul doute aussi à la création de l’AJAR, ce collectif de jeunes écrivains romands qui émerge en 2012. C’est aussi une génération qui a, je crois, davantage confiance en elle. Etre Suisse, écrire en Suisse n’est plus un problème pour eux ; il est loin, le complexe par rapport à la France, comme ont pu le connaître les générations précédentes. La suissitude n’est plus une question: ils portent simplement un regard sur le monde. Et c’est un regard qui n’est pas le mien, raison de mon fort intérêt.
C’est une génération qui a davantage confiance en elle. (…) La suissitude n’est plus une question : ces autrices et auteurs portent simplement un regard sur le monde.
I. R.
Bruno Pellegrino, vous avez fait partie du collectif AJAR (Association de jeunes auteur.e.s romandes et romands) depuis sa création jusqu’en 2021, en parallèle de votre travail individuel d’écrivain. Comment s’est établi le rapport entre les deux ?
Bruno Pellegrino
Cette histoire de collectif m’a vraiment permis de m’affirmer comme auteur individuel, ce qui est loin d’être contradictoire. Pendant toute mon adolescence, j’ai énormément écrit, mais personne n’était au courant. Puis j’en ai parlé à un ami, à un autre ; c’était un processus d’acceptation très long. J’avais honte d’écrire ; j’avais peur que ce soit perçu comme prétentieux ou comme un truc de vieux. J’ai ensuite participé à un concours de nouvelles et reçu un prix, ce qui était un premier pas vers une forme de reconnaissance officielle. Mais, avec le collectif AJAR, j’ai surtout rencontré des gens de mon âge qui écrivaient aussi et avec qui je parlais la même langue, avec qui je rigolais et avec qui j’écrivais. Je n’étais plus seul dans cette démarche, ce qui m’a beaucoup aidé à me considérer comme un écrivain. Je vois ça comme une forme de « coming out ».
I. R.
Ce qui signifiait aussi de renoncer à une forme d’individualité…
B. P.
Oui, mais pour le meilleur: c’est comme ça que j’ai pu exister comme un être singulier. Les salons du livre, les lectures, qui me causaient à la base une grande anxiété, sont alors devenus une source de joie. Grâce à la force du collectif, tout ce qui me semblait difficile ou étrange, comme simplement transmettre une photo à un journal ou encore mener des performances ou des lectures publiques, est devenu un jeu.
I. R.
Le travail avec l’AJAR impliquait des performances, une mise en spectacle du travail, ce que les autrices et auteurs sont de plus en plus amené.e.s à faire en marge de leur travail littéraire, n’est-ce pas ?
B. P.
Dans mon expérience, les performances littéraires peuvent constituer le complément d’un travail d’écriture, ou son prolongement, ou quelque chose de totalement séparé. Il s’agit simplement de l’une des formes possibles de la littérature, qui a d’autres outils – sonores, visuels – et permet de toucher les gens d’une autre manière. Une forme à certains égards plus libre, en ce sens qu’elle est moins appelée à durer. C’est ce qui me plaît dans la performance, ce côté « one shot », ainsi que la proximité du public, l’immédiateté de ses réactions – qui s’oppose, pour le coup, à l’ignorance où je me trouve, en tant qu’auteur, concernant l’effet qu’ont mes textes sur les personnes qui les lisent, au moment précis où elles les lisent. La performance, la scène, fonctionne, de ce point de vue, comme une sorte de laboratoire – qu’est-ce qui fait mouche, qu’est-ce qui percute, qu’est-ce qui tombe à plat –, le lieu d’expériences qui enrichissent, en retour, le travail d’écriture.
La performance, la scène, fonctionne comme une sorte de laboratoire, (…) le lieu d’expériences qui enrichissent, en retour, le travail d’écriture.
I. R.
Caroline Coutau, les lectures publiques ne sont pas une nouveauté, mais les performances, la mise en spectacle de l’auteur par lui-même prennent de plus en plus de place. Est-ce lié à la multiplication des salons du livre ?
C. C.
C’est vrai, les auteurs parlent de leurs textes et les lisent depuis longtemps – voire depuis toujours. Ce qui est nouveau, c’est la création de véritables performances, à la fois complexes, scénarisées, chantées et accompagnées d’images ou de sons. Il y a une demande de la part des festivals, qui sont à la recherche tous azimuts de nouvelles formes de rencontres avec les autrices et auteurs. La présence de l’écrivain face au public – sa gestuelle, son corps, le timbre de sa voix – n’intéresse du reste pas seulement le lecteur standard, elle peut aussi révéler à l’éditeur des facettes qui lui donnent des indices intéressants sur le texte, l’intériorité de l’autrice ou de l’auteur, sa volonté. Et permettront à l’éditeur de mieux travailler lors d’un prochain échange autour de l’écriture. Bien sûr, il y a des risques d’éparpillement pour l’auteur ; à lui de trouver le bon équilibre. Mais c’est un enrichissement. Je crains toutefois que ce ne soit que très rarement l’opportunité de toucher un nouveau public.
I. R.
Y voyez-vous un danger pour le travail de l’auteur.trice et pour celui de l’éditeur.trice ?
C. C.
Si la littérature est aujourd’hui audible sous d’autres formes que le livre, elle est d’abord un acte solitaire, tant au niveau de la création que de la réception. On est dans le silence et l’intime, c’est le propre de l’écriture et de la lecture. Pourtant, pour que le livre existe, l’éditeur doit faire le maximum de bruit autour de sa sortie et de son auteur ou autrice. La part de l’événementiel dans la littérature est vraiment énorme. L’écrivain est devenu comme le comédien de lui-même, et je dois faire en sorte qu’on l’entende dans le plus grand nombre de festivals et de rencontres. Parfois, je me sens comme mangée par la dimension promotionnelle de mon métier ; cela me prend trop de temps, trop d’énergie. Mais c’est une partie absolument nécessaire, il faut jouer le jeu si l’on veut avoir une chance que nos autrices et auteurs soient lus et existent à part entière. Quand je suis déprimée, je maudis cette partie communication, car je me sens si loin de ce qui caractérise la littérature par rapport aux autres arts : le silence et la solitude, le rythme propre à chacun. Mais il y a des périodes dans l’année où je retrouve cette solitude et où je me souviens de mon profond plaisir de lecture.
La part de l’événementiel dans la littérature est vraiment énorme. L’écrivain est devenu comme le comédien de lui-même.
I. R.
Bruno Pellegrino, toutes ces activités promotionnelles ne sont-elles pas également envahissantes pour un écrivain ?
B. P.
L’autre jour, un artiste visuel me disait qu’il était artiste à 5%, et que le reste du temps il n’était que son propre secrétaire particulier. Cela m’a fait rire, mais c’est un peu ça, la réalité. Je n’étais pas préparé à toutes ces formes performatives, ni aux activités annexes organisationnelles qu’elles entraînent. L’AJAR m’a heureusement appris à les gérer. J’aime ces lectures et ces diverses expériences performatives, mais il faut savoir quel engagement important cela implique. Pour moi, les activités de promotion peuvent représenter, dans les meilleurs moments, une récompense après des années de travail solitaire – cette proximité du public dont je parlais au sujet de la performance littéraire, les retours de lectrices et de lecteurs, ces rencontres qui peuvent être d’une grande intensité émotionnelle et me porter, ensuite, dans l’écriture des textes suivants. Dans les moins bons moments, la promotion s’apparente davantage à un mal nécessaire, voire parfois à un mal superflu, qui engendre beaucoup de stress et de découragement – je me dis souvent que ce n’est pas pour ça que j’écris. Mais j’écris pour être lu, et je n’oublie jamais que c’est un privilège d’être invité à parler de mon travail. Simplement, je ne me sens plus obligé de tout accepter au nom de ce sentiment de gratitude, et j’apprends progressivement à sélectionner ce qui me semble avoir du sens, et à dire non au reste.
I. R.
Caroline Coutau, vous avez passé commande pour un feuilleton littéraire à trois membres de l’AJAR, Aude Seigne, Bruno Pellegrino et Daniel Vuataz. Etait-ce dans l’idée de vous ouvrir à de nouveaux publics, friands de séries télévisées ?
C. C.
C’est la première fois que je faisais une chose pareille. D’autant plus que, pour moi, c’est déjà étrange de « passer commande » à un unique auteur littéraire ; alors à plusieurs, vous imaginez ! J’avais par ailleurs lu Vivre près des tilleuls, leur roman collectif, à sa parution chez Flammarion. Le « pitch » me plaisait, mais dix-huit auteurs, pour moi, c’était trop : il me manquait une voix, une tonalité. C’est finalement en voyant le trio fonctionner que j’ai trouvé mon déclencheur : je les ai vus comme trois corps et une seule tête ! L’un terminait les phrases de l’autre ; il existait un rapport quasi organique entre eux qui me fascinait. Ils parlaient aussi beaucoup de séries télévisées, un domaine que je ne connaissais absolument pas. Ils m’ont alors initiée au genre avec Breaking Bad. J’ai été émerveillée, j’ai trouvé ça terriblement addictif. Je leur ai alors proposé de travailler comme une équipe de scénaristes pour écrire l’équivalent d’une série télé, sur le mode du feuilleton. Il me semblait qu’à trois, c’était jouable. C’était le début de l’aventure de Stand-by.
I. R.
Et, pour vous trois, que représentait cette commande d’écriture collective ?
B. P.
Au début, avec l’AJAR, il n’était pas question d’écrire des romans. On voulait surtout faire de la littérature hors du livre. L’écriture de Vivre près des tilleuls s’est faite presque par accident, et sa publication encore plus. D’ailleurs, s’il existe beaucoup de collectifs d’écriture, il y a généralement toujours une ligne rouge infranchissable, celle du style individuel. Chacun écrit et signe son propre texte, puis on en forme un recueil. Mais l’AJAR a franchi cette fameuse ligne en déclarant que le texte pouvait aussi être une création commune. Pour en revenir plus précisément à cette commande qui donnera naissance à la série d’ouvrages Stand-by, tout commence par de longues discussions, au cours desquelles l’histoire prend forme, avec la définition des lieux, des personnages, de l’intrigue. Car le processus d’écriture ne vient pas de nulle part, et l’art commence toujours dans la vie, que l’écriture soit individuelle ou collective. D’où ces discussions intenses du début. Puis vient la rédaction. Mais rédiger des phrases avec la conscience qu’elles rejoindront la boîte commune, ça change évidemment le rapport à l’écriture. Car chacun peut librement intervenir dans le texte de l’autre, sans se poser de questions. Quoi de plus intime que de donner à lire à quelqu’un une page en chantier? C’est un véritable exercice de vulnérabilité.
Dans l’écriture collective, chacun peut librement intervenir dans le texte de l’autre, sans se poser de questions. Quoi de plus intime que de donner à lire à quelqu’un une page en chantier ? C’est un véritable exercice de vulnérabilité.
I. R.
Quelle différence y a-t-il, pour l’éditrice, entre le travail avec un collectif et celui avec un.e seul.e auteur.trice ?
C. C.
Ils sont comme leurs propres éditeurs, en allant même un pas plus loin que moi. Ils ne s’avertissent pas au préalable des changements à opérer : s’ils trouvent qu’il y a trop d’adjectifs, ils les enlèvent ! J’étais véritablement émerveillée de la confiance qu’ils s’accordent mutuellement, et chacun est prêt à laisser malmener sa phrase pour le mieux. Du coup, je suis peu intervenue. Je voyais régulièrement l’état du texte et je cherchais à deviner qui écrivait quelle part. J’y ai vite renoncé par inutilité, car la page que je lisais avait subi trop de modifications. Quand l’état du texte a été jugé bon par tous, j’ai fait mon travail d’éditrice comme si j’avais un seul auteur face à moi.
I. R.
Comment Stand-by a-t-il été reçu? Pensiez-vous toucher un nouveau public ?
C. C.
L’accueil a été très différent selon le pays. En France, c’était une catastrophe. Ni les libraires ni les lecteurs n’ont suivi, alors que le diffuseur était pourtant enthousiaste. Cette notion de collectif leur échappait complètement, c’était trop étrange. En Suisse, le premier épisode a bien marché, notamment grâce aux enseignants de français, qui y ont vu une belle matière à étudier en classe. Mais la suite n’a pas eu le même succès, car la majorité des élèves ne lisent souvent que s’ils doivent le faire. Du coup, oui, nous avons touché un public plus jeune, mais pas sur la durée.
I. R.
Un deuxième ouvrage collectif de votre trio, intitulé Terre-des-Fins, va paraître ces jours aux Editions Zoé, cette fois à la demande du Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains (mudac) de Lausanne, en lien avec l’inauguration des deux nouveaux musées de Plateforme 10. Pouvez-vous nous en dire plus ?
B. P.
Pour Stand-by, on avait logiquement beaucoup travaillé l’intrigue, les cliffhangers, le suspense. Avec Terre-des-Fins, on voulait garder ces éléments tout en tentant quelque chose de différent. D’ailleurs, la commande stipulait le genre spécifique à suivre : comme Plateforme 10 est situé au bord des rails et que l’exposition inaugurale porte sur la thématique ferroviaire, la commande était d’écrire un « roman de gare ». Il fallait aussi introduire dans le texte des éléments de l’exposition sur l’univers des trains. Pour le reste, nous étions libres de l’histoire, comme pour Stand-by. On a aussi choisi un récit à la première personne, ce qui change tout (lire le commentaire d’Isabelle Rüf). La narratrice est une jeune femme, qui n’est pas du tout notre alter ego : elle vit dans une petite ville minière au bout du monde. Du coup, on s’est vraiment interrogés sur son langage, son vocabulaire, les mots qu’elle connaît, ce qu’elle ne dirait jamais, ses tabous. Ces éléments, que l’on peut trouver psychologisants, déterminent en réalité le son de la langue. Et c’est encore plus essentiel de faire ce travail en amont quand il faut parler en « je » d’une seule voix.
I. R.
Un roman de gare publié aux Editions Zoé, c’est aussi une première. Vous aviez déjà innové avec une autre forme populaire, le roman policier.
C. C.
Le roman de gare peut être considéré par certains comme un genre « bas de gamme », au même titre que la série TV l’était par rapport au cinéma à une époque. Mais ce qui caractérise la génération de ces trois autrice et auteurs, c’est qu’elle ne hiérarchise pas entre la culture populaire et celle dite érudite, ou sérieuse ; alors que moi, si. J’ai appris à distinguer la bonne et la mauvaise littérature, de même pour la musique, les arts visuels… Pourtant, on peut véritablement faire un roman populaire de bonne qualité ; j’assume pleinement cet ouvrage au corpus des Editions Zoé. Tout comme pour les romans policiers, c’est toujours une écriture qui guide mon choix. Au fond, peu importe le genre : il faut que je sente une voix, une tonalité, une vitesse (ou une lenteur) caractéristique et, même si je suis mal à l’aise avec les grands mots, une nécessité.
Cette génération ne hiérarchise pas entre culture populaire et érudite ; moi j’ai appris à les distinguer. (…) Pourtant, on peut véritablement faire un roman populaire de bonne qualité.
B. P.
Qu’est-ce qu’un roman de gare, en définitive ? C’est un récit assez court qui doit pouvoir être lu en deux heures et qui doit donner envie de tourner les pages rapidement. Il faut, du coup, de la tension narrative. Le genre véhicule aussi le plus souvent d’affreux clichés machistes et homophobes, avec un héros très viril et une femme à demi-nue en couverture. On n’allait évidemment pas faire ça ! Mais on pouvait jouer avec ces codes et les déjouer. Pour l’image de couverture, nous avons ainsi cherché un élément visuel qui puisse faire écho au mudac et au thème du train. Nous avons alors pensé aux graffitis, qui sont aussi une forme d’art collectif. L’idée a plu et le mudac en a même introduit dans l’exposition.
I. R.
Comptez-vous continuer dans cette dynamique collective ?
B. P.
Pour moi, c’est une évidence. C’est pour ça que nous lançons avec Aude Seigne, Daniel Vuataz et Fanny Wobmann un studio d’écriture collective appelé la ZAC, dans l’idée de zone à créer, à cohabiter, à chérir… C’est une structure dont tous les projets seront collectifs : écriture de scénarios, podcasts, textes de théâtre, romans, feuilletons, et j’en passe. Un premier échantillon a d’ailleurs été publié dans Le Courrier. Il s’agit justement d’un feuilleton en quatre épisodes, destiné aux enfants, pour le Théâtre Le Reflet, à Vevey. Il y a tellement de choses à faire et de formats à explorer !
I. R.
L’idée d’écriture collective fait-elle son chemin au niveau de sa réception institutionnelle ?
B. P.
Ce qui m’étonne, c’est que quasiment rien n’est prévu pour le collectif au sein des institutions qui soutiennent le travail d’écriture. Bien sûr, le collectif AJAR a été beaucoup soutenu, a obtenu des aides, des soutiens structurels, etc. Mais je voudrais soulever la difficulté à faire reconnaître l’écriture collective comme une forme sérieuse de création littéraire, aussi valable qu’une autre. Il y a des exceptions, bien sûr, mais j’observe que dans l’ensemble cette pratique reste marginale : les journaux hésitent à chroniquer des œuvres collectives, les festivals sont frileux, notamment parce que cela coûte évidemment plus cher d’inviter trois, quatre ou dix auteurs et autrices au lieu d’un.e seul.e. C’est d’ailleurs la même problématique pour les résidences d’écriture. C’est notamment là, il me semble, que des soutiens financiers pourraient intervenir. La question des droits d’auteur est également balbutiante, et il faut se livrer à toute une gymnastique pour contourner des structures administratives rigides qui ne sont pas (encore) prévues pour accueillir ces formes d’écriture.
Je voudrais soulever la difficulté à faire reconnaître l’écriture collective comme une forme sérieuse de création littéraire, aussi valable qu’une autre.
I. R.
Ce qui renvoie à la question de la professionnalisation du métier. L’AJAR s’est beaucoup engagée pour la reconnaissance financière des prestations des autrices et auteurs. Qu’en est-il aujourd’hui ?
C. C.
Hormis quelques autrices et auteurs de best-sellers – Musso, Dicker, Lévy, Nothomb… –, aucun écrivain francophone ne vit de sa plume strictement littéraire. La génération de Bruno invente du coup toutes sortes de manières de gagner de l’argent avec l’écriture, de façon très pragmatique. Il y a aussi beaucoup plus de bourses, de prix et de résidences qu’il y a vingt ans. Mais cet argent va surtout aux premiers romans. Suite à une première reconnaissance, un jeune auteur parvient généralement à récolter passablement de soutiens financiers, puis cette manne s’épuise souvent après trois ou quatre ans. C’est la fin des années bénies. Les auteurs doivent alors se réinventer et trouver d’autres manières de faire. Les écrivains de ma génération sont souvent professeurs, ce qui assure un certain confort, mais ils et elles vivent avec cette frustration de ne pas avoir de temps pour écrire. Aujourd’hui, les autrices et auteurs prennent plus facilement le risque d’une vie matérielle précaire pour conserver la main sur leur mode de vie. Ils travaillent pendant un an ou deux, mettent de l’argent de côté, pour retourner ensuite au statut d’indépendant pendant un temps, sans trop de sueurs froides. C’est un rapport au travail différent, que l’on observe aussi dans d’autres disciplines artistiques. Il offre une formidable liberté, mais avec moins de confort. Mais c’est aussi à nous, les éditeurs, de convaincre ceux qui invitent des auteurs dans des librairies ou des festivals : ces temps de lecture publique doivent être rétribués. C’est une pratique tout à fait courante dans les pays de langue allemande, où les auteurs vivent de ces prestations, mais ici, il y a encore beaucoup à faire ! D’ailleurs, les écrivains commencent à s’organiser par eux-mêmes.
Aujourd’hui, les autrices et auteurs prennent plus facilement le risque d’une vie matérielle précaire pour conserver la main sur leur mode de vie. (…) C’est un rapport au travail différent.
B. P.
Pour ma part, je suis encore dans la période faste, là, en résidence à Rome pour un an. Est-ce que je vais continuer à écrire ainsi jusqu’à ce que mort s’ensuive ? Je n’en sais rien. Il y a tant de choses qui m’intéressent en lien avec la littérature. Mais, très concrètement, j’ai fait le choix, il y a plusieurs années, de mettre l’écriture au centre et de renoncer à bien des choses. Je ne le vis pas comme un sacrifice ; j’assume ce choix de bout en bout. C’est vrai, je pourrais très bien enseigner au gymnase, avec un bon salaire à la clé et une forme de régularité. Mais j’ai choisi une autre vie.

Caroline Coutau dirige les Editions Zoé, à Genève, depuis 2011. Auparavant, elle s’était familiarisée avec les métiers de l’édition en collaborant avec Labor et Fides, dans les domaines des sciences humaines et du contact avec la presse, puis au sein de Noir sur Blanc, où elle supervisait des traductions. Enfin, elle a collaboré pendant plus de deux ans avec Marlyse Pietri, fondatrice de Zoé, avant de reprendre les rênes de la maison. Le Prix culturel Leenaards lui a été remis en 2021 « pour son travail incessant en faveur de la littérature ».

Bruno Pellegrino est l’auteur de trois romans : Comme Atlas (Tind, 2015, puis Zoé Poche en 2018), Là-bas, août est un mois d’automne (2018) et Dans la ville provisoire (2021), tous deux édités chez Zoé. En parallèle, l’auteur participe au collectif AJAR (Association de jeunes auteur.e.s romandes et romands) pendant près de dix ans, depuis sa fondation en 2012. Il fait désormais partie de la ZAC, studio d’écriture collective qui vient tout juste d’être créé. Il reçoit en 2016 la Bourse culturelle Leenaards « pour l’assurance dans son écriture, qui frappe par sa solidité et sa liberté ».
Stand-by reprend, sous forme de feuilleton littéraire, les codes de la série télévisée. Des jeunes gens de l’âge de l’autrice et des auteurs parcourent un monde ravagé par une éruption volcanique, ce qui permet d’aborder sur le mode ludique le dérèglement climatique, les relations de genre, le rapport à l’altérité. Cette com- mande des Editions Zoé, une série publiée entre 2018 et 2019, est le premier ouvrage d’un collectif à trois têtes issu de l’AJAR : Bruno Pellegrino, Aude Seigne et Daniel Vuataz.
Une deuxième commande les a réunis tout récemment. Pour l’inauguration, en juin 2022, du pôle muséal Plateforme 10, situé à côté de la gare de Lausanne, le mudac (Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains) a sollicité le trio pour écrire un « roman de gare ». Au contraire du foisonnement choral de Stand-by, Terre-des-Fins est porté par une seule voix, celle d’une jeune fille, Liv. Le récit se déroule dans une ville minière désertée où le train ne s’arrête que rarement. Liv et son frère sont des marginaux, ils vivent en pillant les convois qui passent. Leur passion consiste à couvrir les wagons de graffitis multicolores. Quant à la ville où ils vivent, elle a pour seule attraction l’œuvre d’un artiste qui crée avec le minerai abandonné des œuvres monumentales et toxiques. C’est alors qu’une jeune critique d’art de la capitale, venue emporter des sculptures pour une grande exposition, souhaite rencontrer l’artiste qui ne se laisse plus approcher. Liv lui fait miroiter un rendez-vous. S’ensuit la folle équipée des deux femmes.
Portrait d’une ville fantôme où rêvent deux enfants perdus, Terre-des-Fins (éd. Zoé, 2022) est un conte noir, burlesque, violent et poétique, qui interroge les dérives de l’art contemporain et célèbre la liberté du geste du/de la graffeur.euse.
Isabelle Rüf, journaliste littéraire

Interview avec: Dre O. Braillard, Dr R. Descartes, Dre M. Nehme et C. Sauthier
Par M. Balavoine, réd. en chef Planète Santé
Michael Balavoine
Comment le Covid long vous a-t-il permis de vous réunir autour de ce projet commun de métamodèle ?
Olivia Braillard
Le Covid long est une porte d’entrée idéale pour discuter avec des thérapeutes complémentaires. Tout simplement parce que la médecine conventionnelle que nous pratiquons dans nos centres hospitalo-universitaires n’a malheureusement pas grand-chose à proposer face à cette pathologie. En effet, celle-ci nous oblige à sortir des schémas classiques, y compris du fameux axe biopsychosocial. Avec le Covid long, une grande partie de la situation nous échappe. Il s’agit, du coup, d’élargir les perspectives thérapeutiques et, pour cela, de rassembler les différentes approches et de partager les points de vue d’horizons divers. Lors de la rencontre organisée par la Fondation Leenaards, nous nous sommes rendu compte que le fait de réaliser un bilan ensemble avec les patientes et patients devait être la toute première étape. De mon point de vue de généraliste hospitalière, c’est une occasion de faire de la « narrative-based medicine » : on sort des données et des chiffres pour écouter le vécu des patientes et patients. Puis on se sert de leurs narrations comme base d’un processus de guérison. L’idée du projet que nous menons peut paraître banale, mais le fait de se constituer en un groupe de soignants avec des approches très diverses pour offrir une prise en charge la plus cohérente possible se fait encore très peu en médecine générale. Une telle manière de collaborer évite par ailleurs certainement des formes d’errance thérapeutique très pénibles à vivre pour les personnes concernées.
De mon point de vue de généraliste hospitalière, c’est une occasion de faire de la « narrative-based medicine » : on sort des données et des chiffres pour écouter le vécu des patientes et patients. Puis on se sert de leurs narrations comme base d’un processus de guérison.
Mayssam Nehme
A la consultation de Covid long du Service de médecine de premier recours est très rapidement apparue une nécessité absolue de coordination avec les différents professionnels de santé et avec les patientes et patients. Pas seulement parce que nous n’avons que peu de thérapies à proposer, mais aussi parce que ces malades ont souvent recours aux thérapies alternatives. Ce type d’attitude se retrouve d’ailleurs souvent dans le cadre des maladies chroniques telles que la douleur ou la fatigue. Or, il existe une explosion de l’offre dans le domaine des thérapies alternatives. Pour un médecin généraliste, savoir pourquoi recommander une approche alternative plutôt qu’une autre s’avère très difficile. Sans même parler de son rapport avec la médecine conventionnelle, le domaine des thérapies complémentaires manque de coordination. Ce projet Leenaards va nous permettre, non pas de trouver une solution – il faut rester humble face à cet immense défi –, mais de commencer à réfléchir à des améliorations en termes de coordination des soins. Laquelle constitue une de nos tâches centrales dans un service de médecine de premier recours.
Le Covid long nous démontre une réalité observée pour de nombreuses autres maladies chroniques : si les médecins ne travaillent pas en équipe multidisciplinaire, les patientes
et patients se chargent eux-mêmes de créer cette équipe thérapeutique autour d’eux.
René Descartes
En fait, le Covid long nous démontre une réalité observée pour de nombreuses autres maladies chroniques : si les médecins ne travaillent pas en équipe multidisciplinaire, les patientes et patients se chargent eux-mêmes de créer cette équipe thérapeutique réunissant divers professionnels de santé autour d’eux, notamment en provenance des médecines alternatives. Parfois, le risque pour le patient est d’exclure le médecin dit conventionnel de « l’équipe », par peur d’être jugé ou désapprouvé, ce qui péjore à la fois la qualité du dialogue et celle des soins. On se retrouve alors face à une fragmentation entre différents acteurs thérapeutiques, agissant isolément, ce qui entraîne un véritable risque de dysfonctionnement du système de soins au sens large du terme.
Christophe Sauthier
Il y a ce besoin de coordination, c’est certain, mais aussi de partage des connaissances. En tant qu’ostéopathe, j’ai appris, lors de l’anamnèse, à éliminer ce qui n’est pas de mon ressort et que je dois référer ailleurs. Une fois les problèmes graves écartés, l’ostéopathe a un credo : c’est le corps qui commande. On cherche à voir et à sentir ce qui se passe dans les tissus. Mais, au-delà de cette approche propre à ma pratique, comment fonctionnent les autres thérapies complémentaires ? Ce sont cette curiosité et ce besoin de compréhension des autres approches que je trouve essentiels dans ce projet. Il y a bien sûr les thérapies alternatives classiques, qui sont déjà largement pratiquées dans les hôpitaux, comme la méditation ou l’hypnose. Mais, dans ce projet, il y a la volonté d’élargir le champ des possibles, d’aller à la rencontre de modes de pensée complètement différents, pour voir si des convergences sont possibles et augmenter le champ d’action et d’investigation.
Il y a ce besoin de coordination, c’est certain, mais aussi de partage des connaissances. En tant qu’ostéopathe, j’ai appris, lors de l’anamnèse, à éliminer ce qui n’est pas de mon ressort et que je dois référer ailleurs.
M. B.
Concrètement, comment allez-vous organiser ce partage ?
O. B.
C’est une partie intégrante du projet, mais nous n’avons pas de baguette magique ! Nous avons besoin d’expérimenter par nous-mêmes pour trouver la bonne méthode. Se mettre à plusieurs thérapeutes avec une patiente ou un patient constitue déjà une première pour ce genre de pathologie. Il va falloir déterminer ce dont chacune et chacun a besoin pour mieux appréhender la pratique des autres. Un patient partenaire a par ailleurs été intégré à la démarche. Car l’idée de notre grille d’analyse n’est pas qu’elle serve uniquement aux praticiennes et praticiens pour dialoguer entre eux, mais aussi qu’elle participe à une meilleure interaction avec les personnes malades. Car c’est bien auprès d’elles que doivent se rejoindre toutes les démarches thérapeutiques.
M. B.
Vous dites que cette approche intégrative est une première. Ne devrait-elle pas être la norme pour de nombreuses autres pathologies complexes ?
O. B.
Le cœur du travail des médecins de premier recours est de coordonner. Ils et elles le font déjà pour la médecine conventionnelle en rassemblant les cardiologues, les pneumologues ou encore les infectiologues autour d’une même situation. Réunir les avis, analyser et prendre une décision ensemble avec le patient ou la patiente : cette intégration est le moteur même de notre pratique. En revanche, ajouter les médecines complémentaires à notre pratique se fait encore peu. Néanmoins, se diriger vers cette forme d’intégration plus large me paraît être une évolution naturelle du travail des médecins généralistes. Il y a trente ans dominait une médecine dite « monopathologique », essentiellement infectieuse. Cette médecine s’est transformée en quelque chose de plus complexe : on soigne mieux, mais les personnes vivent du coup avec plusieurs pathologies concomitantes. Pour faire face à ces nouveaux besoins, il me semble dès lors tout à fait légitime d’intégrer des approches plus larges. Les médecins de premier recours, en tout cas en Suisse, sont sans doute les spécialistes les plus adéquats pour effectuer ces bilans intégratifs et jouer ainsi un rôle de pivot entre les différents mondes de la santé. Pour l’heure, les approches intégratives entrent encore par la porte des pathologies pour lesquelles la médecine conventionnelle n’a que peu de solutions à proposer. A terme, je pense que toutes les maladies chroniques devraient bénéficier d’une consultation intégrative. C’est un changement culturel. Il sera certainement progressif, mais le mouvement est en marche et il faut l’accompagner pour le rendre harmonieux.
A terme, je pense que toutes les maladies chroniques devraient bénéficier d’une consultation intégrative. C’est un changement culturel. Il sera certainement progressif, mais le mouvement est en marche.
C. S.
En réalité, ce type d’approche qui allie les médecines conventionnelles et complémentaires correspond déjà au parcours que font de nombreux patients et patientes. L’idée au cœur de notre projet, c’est de rendre ce cheminement plus cohérent, moins informel et surtout plus efficace. Le grand enjeu est certes d’ouvrir les possibles, mais plus encore de veiller à ce que la personne ne soit pas perdue avec un premier thérapeute qui lui parle de souffle de vie, un autre de vertèbres et un dernier du qi (l’énergie en médecine chinoise, ndlr). Notre projet vise ainsi à proposer quelque chose de structurant autour de l’offre actuelle et à expliciter le « qui fait quoi à quel moment» du processus thérapeutique.
Face à l’actuelle explosion des thérapies alternatives et complémentaires, les patientes et patients peinent en effet à s’y retrouver. Nous ne pouvons pas simplement les laisser livrés à eux-mêmes !
M. N.
Face à l’actuelle explosion des thérapies alternatives et complémentaires, les patientes et patients peinent en effet à s’y retrouver. Nous ne pouvons pas simplement les laisser livrés à eux-mêmes ! Et même si nous manquons encore cruellement de données et d’informations pour les aider, nous nous devons de les accompagner le mieux possible.
R. D.
C’est vrai qu’il faut imaginer une intégration qui soit bidirectionnelle. D’un côté, la médecine universitaire qui s’ouvre peu à peu à de nouvelles approches. De l’autre, les médecines alternatives qui acceptent l’idée d’une telle collaboration et la nécessité de mener des travaux de recherche sur la valeur ajoutée d’une approche intégrative pour la santé.
M. B.
Cette approche intégrative change-t-elle aussi la place occupée par les malades ?
C. S.
Oui, c’est une manière de leur redonner les manettes. La personne n’est plus là juste pour écouter, mais se voit restituer le savoir qui lui appartient. Elle peut faire des choix. Il me semble très important que chaque patiente ou patient puisse se réapproprier cette force de décision et déterminer ce qui est juste et important pour elle ou lui. La personne devient ainsi un être vivant multifacette et multidimensionnel qui interagit avec les nombreux éléments de son environnement qui peuvent soit perturber, soit harmoniser son potentiel de santé. Il faut dès lors dépasser le descriptif du contenu de ce qui est vécu pour en revenir au ressenti des patientes et patients, au travers de leur expérience de vie. Voilà l’unicité de chacune et chacun qui entre en jeu. Ainsi, deux personnes dans une situation qui paraît à la base identique au niveau des symptômes et de la pathologie ne vont en effet pas développer la même réponse si le contexte physique, émotionnel, mental ou spirituel est différent. Une approche intégrative permet de prendre en compte ces différentes dimensions dans la réponse « biologique » donnée. Un regard plus large sur la santé est ainsi offert.
O. B.
Il s’agit en effet d’une approche qui dépasse les soins pour s’intéresser à l’être vivant dans sa globalité. Nous ne sommes plus dans un schéma où un médecin reconnaît une pathologie et prescrit le bon médicament, ni d’ailleurs dans celui, dit « patient centré », où ce dernier reçoit un message coordonné de plusieurs spécialistes. Non, là, nous parlons de « personne concernée ». Le terme n’est peut-être pas très bien choisi, mais il veut bien dire que nous ne sommes plus dans une relation hiérarchique : tout le monde fait partie de la même équipe. Il s’agit d’un partenariat.
Deux personnes dans une situation qui paraît à la base identique au niveau des symptômes et de la pathologie ne vont en effet pas développer la même réponse si le contexte physique, émotionnel, mental ou spirituel est différent. Une approche intégrative permet de prendre en compte ces différentes dimensions.
R. D.
Cette vision horizontale de la situation, où chacun fait partie d’une même équipe, est essentielle. Sur un plan pragmatique, cela aide à recueillir et intégrer de nombreuses informations sur la personne et ses différentes dimensions. Des données qui pourraient sembler potentiellement anodines dans le cadre d’une consultation conventionnelle, mais qui ont tout leur sens dans une approche intégrative. Dans ce cadre, il est dès lors essentiel que la personne se sente véritablement écoutée et entendue.
M. B.
Votre projet s’inscrit dans un service de médecine universitaire. Est-ce le signe d’un changement de perception et de culture dans ce milieu ?
M. N.
Dans le monde hospitalo-universitaire, il existe une sensibilisation aux approches intégratives plus grande que par le passé, comme c’est d’ailleurs le cas dans l’ensemble de la société. Cette évolution n’a pas attendu notre projet pour être initiée. En revanche, le Covid long a permis de déstigmatiser certains symptômes, tels que la fatigue chronique, qui peuvent parfois être mal perçus dans les institutions universitaires. On croit encore trop souvent que ces troubles se situent « dans la tête » des individus. Or, l’énorme savoir-faire du monde scientifique commence à mettre en lumière la réalité de syndromes jusqu’ici négligés. Le Covid nous a obligés à investiguer la physiopathologie de maladies pour lesquelles la médecine conventionnelle n’avait que peu d’intérêt. Et comprendre ce qui se passe dans le corps aide à une véritable reconnaissance du problème.
Dans le monde hospitalo-universitaire, il existe une sensibilisation aux approches intégratives plus grande que par le passé, comme c’est d’ailleurs le cas dans l’ensemble de la société. Cette évolution n’a pas attendu notre projet pour être initiée.
M. B.
Ce projet représente-t-il aussi un moyen pour la pratique de terrain de profiter des compétences du monde académique ?
O. B.
Oui. Travailler dans un milieu universitaire permet de mettre les méthodologies de la médecine conventionnelle au service de la médecine intégrative. Les protocoles et la mesure des résultats, nous maîtrisons. Dans le cadre de notre projet pilote, nous allons dans un premier temps suivre un petit groupe de cinq personnes. Le but n’est pas d’obtenir des changements fondamentaux, comme une évolution de l’échelle de la douleur. Nous nous intéresserons davantage à leur ressenti. Par exemple, cette approche a-t-elle permis à la personne d’être mieux écoutée ? Y a-t-il des gains subjectifs pour elle ? Est-elle devenue actrice de sa situation ? Dans un deuxième temps, nous essaierons d’élargir la démarche, avec l’objectif que ce modèle puisse sortir des murs de l’hôpital et contribuer à une transition vers des pratiques de soins plus larges.
M. B.
Avez-vous l’impression que le système de santé actuel va aider à la transformation intégrative que vous appelez de vos vœux ?
M. N.
Notre espoir est de développer et généraliser ces approches intégratives à l’ensemble des maladies chroniques. Pour cela, il faudrait que ces prises en charge soient remboursées par l’assurance maladie. Malheureusement, les récentes décisions politiques vont dans le sens contraire. Au niveau de la tarification, le temps de coordination remboursé a plutôt diminué pour la gestion des maladies complexes. Or, organiser tout cela demande du temps. Ce n’est pas qu’une affaire d’aiguillage. Pour piloter les trajectoires individuelles au plus près des besoins, il faut de l’écoute, un esprit de synthèse et énormément d’échanges entre professionnels et avec les patients. Ce travail de suivi rapproché est crucial, mais cependant très peu valorisé.
O. B.
Nous pouvons faire cet énorme travail de coordination dans un centre universitaire parce que, dans le cadre de la recherche, nous pouvons nous permettre de ne pas faire de la rentabilité l’unique priorité. Mais l’industrialisation du système de soin rend cette mutation compliquée. Beaucoup de choses restent à changer dans le modèle de financement pour que ce travail de coordination entre les différents mondes de la santé devienne possible. Pour cela, il faudra montrer que cette approche est efficace pour les patientes et patients.
C. S.
J’ai l’impression que si un projet comme le nôtre peut se développer dans un centre hospitalo-universitaire, c’est un signe que le système a déjà commencé à bouger. Non parce qu’il l’a voulu ou que les caisses maladie le souhaitent : ces approches intégratives gagnent en importance parce que de plus en plus de patientes et patients en font le choix. A la longue, leurs besoins, leurs envies, leur curiosité obligeront le système de santé, dans sa globalité, à s’adapter.
R. D.
De nombreuses résistances peuvent apparaître. Mais il me semble aussi que ce mouvement vers plus d’intégration est en marche. Il devra néanmoins faire ses preuves tant sur le plan de l’efficacité que sur celui du respect des coûts. Intégrer les pratiques conventionnelles et non conventionnelles, c’est en définitive rendre le système actuel plus fonctionnel ; c’est forts de cette conviction que nous restons confiants pour l’avenir.
Ce mouvement vers plus d’intégration est en marche. Il devra néanmoins faire ses preuves tant sur le plan de l’efficacité que sur celui du respect des coûts.

Médecin spécialiste en médecine interne générale, Olivia Braillard travaille au Service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) depuis 2010. En accompagnant des malades chroniques, elle développe un intérêt pour l’éducation thérapeutique du patient (ETP) ainsi que pour les approches biographiques de la relation médecin-malade.

Médecin diplômé depuis 1991, René Descartes a obtenu son doctorat de médecine en 1995. Il a par la suite suivi des formations approfondies en acupuncture et en homéopathie. Il exerce à titre indépendant depuis 1995.

Après sa formation en médecine interne générale aux Etats-Unis, Mayssam Nehme intègre le Service de médecine de premier recours des HUG dès 2016. Cheffe de projet du dispositif genevois de la coordination des soins de la personne âgée fragile (COGERIA) de 2018 à 2021 – et plus récemment coordinatrice de la consultation post-Covid aux HUG –, elle se rend compte à quel point une prise en charge holistique est nécessaire pour bien soigner les patient.e.s.

Ostéopathe diplômé de l’Ecole suisse d’ostéopathie, Christophe Sauthier travaille en cabinet privé multidisciplinaire – alliant médecine, naturopathie, acupuncture, thérapie psycho-corporelle, suivi pré et post-natal et massages – depuis 1998.
Pour documenter ses découvertes, la science médicale a l’habitude d’utiliser des graphiques et des tableaux. Tous les articles scientifiques s’appuient en effet sur des chiffres et des comparaisons. C’est ainsi qu’ils démontrent l’efficacité d’une molécule, la dangerosité ou encore l’inefficacité d’une autre. Mais cette conception « par la preuve » de la médecine ne suffit plus à faire face à la complexité des maladies chroniques. C’est ce que souligne le projet de « métamodèle intégratif » développé par Olivia Braillard, René Descartes, Mayssam Nehme et Christophe Sauthier. Pour répondre aux défis posés par le suivi de maladies sur le long terme, il faut désormais innover au niveau de l’organisation même des soins, afin d’en assurer la coordination globale et l’accès équitable. Ce qu’il faut construire, c’est un parcours sanitaire cohérent qui, du centre hospitalier expert au domicile du patient, mette en musique les compétences de nombreux.ses acteur.trice.s d’horizons divers. Le but ? Délivrer à la personne concernée le bon service, au bon moment et au bon endroit.
Il s’agit dès lors de faire évoluer le système de santé dans sa manière de fixer les règles de cette coopération complexe. Mais comment s’y prendre pour produire des connaissances dans ce domaine ? Le projet financé par la Fondation Leenaards propose une approche novatrice où le chemin de la connaissance passe par des innovations issues du terrain, c’est-à-dire d’une pratique soignante locale. Dans un travail déjà ancien, le spécialiste du changement au sein des organisations Frank Blackler écrivait que, dans ce genre de cas, la production de la connaissance résulte d’un processus en train de se faire, certes intermédié par la technologie et le langage, mais surtout localisé dans l’espace et constamment en mouvement1.
Le projet de « métamodèle » développé dans le cadre de l’initiative Santé intégrative & société est de cet ordre. Il consiste en une interaction nouvelle entre différents professionnels de santé, donnant un rôle central aux relations avec le patient ou la patiente. Son objectif est que des processus plus individualisés et plus adaptés à la complexité des prises en charge puissent voir le jour. Et son émergence est le fruit d’un échange constant entre différent.e.s acteur.trice.s. Rien ou presque n’y est défini à l’avance. Ce « bricolage » nécessaire à la production des connaissances est sans nul doute moins spectaculaire que la mise au jour d’une thérapie spécialisée. Mais il est et restera crucial pour répondre aux enjeux majeurs de durabilité et d’efficacité du système de soins.
Michael Balavoine, rédacteur en chef de Planète Santé
1. BLACKLER, F. (1995), Knowledge, Knowledge Work and Organizations : An Overview and Interpretation, Organization Studies, 16(6), 1021-1046.

Interview avec Yuri Tironi, Prof. associé à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) HES-SO
Propos recueillis par Blaise Willa, rédacteur en chef du magazine générations
Blaise Willa
Qu’est-ce que l’action communautaire, cette thématique « pleine de vitalité », que vous décrivez dans votre ouvrage L’action communautaire. Une praxis citoyenne et démocratique ?
Yuri Tironi
L’action communautaire est en effet pleine de vitalité, car elle est protéiforme, elle s’appuie sur de nombreux modèles. Mais au cœur, toujours, se trouve l’élan de base : comment faire pour que le citoyen et la citoyenne soient les auteurs et les acteurs de leur propre environnement, qu’il s’agisse de le maintenir quand il donne satisfaction ou de le faire évoluer quand il dysfonctionne? Chacun devrait en effet disposer d’un pouvoir sur sa propre organisation, sur son propre environnement, par l’action commune, pour résoudre un problème et se sentir en capacité d’agir. L’action professionnelle peut alors intervenir de manière plus ou moins accentuée selon les ressources et capacités du collectif. Ainsi, si les membres du collectif sont d’un milieu socio-économique relativement aisé, on aura plus souvent affaire à des personnes qui possèdent déjà une capacité délibérative, une capacité d’argumentation et d’organisation qui nécessiteront un accompagnement moins soutenu. Dans un quartier moins favorisé par contre, le curseur sera déplacé par le professionnel vers un accompagnement plus soutenu; il aura généralement affaire à des citoyens qui maîtrisent mal les codes institutionnels et administratifs. Selon l’action ou le projet à entreprendre, le collectif aura alors besoin de ce type d’accompagnement plus appuyé.
Chacun devrait disposer d’un pouvoir sur sa propre organisation, sur son propre environnement, par l’action commune, pour résoudre un problème et se sentir en capacité d’agir.
B. W.
Vous postulez d’emblée que l’intervention de professionnel.le.s est requise, quel que soit le terrain. On ne peut donc pas agir seul dans le cadre d’une action communautaire ?
Y. T.
Je ne le postule pas d’emblée, car on parlerait, dans ce cas, de travail social communautaire. L’action communautaire, elle, englobe autant l’action professionnelle que l’action volontaire bénévole. Dans l’ouvrage collectif que j’ai eu l’opportunité de diriger, il y a des exemples de projets où aucun professionnel n’a été impliqué. Mais les personnes qui peuvent apporter d’elles-mêmes une pareille dynamique dans ces projets ont toutes derrière elles une formation ou une expérience dans le travail social.
B. W.
On n’est donc pas tous égaux en matière d’action communautaire…
Y. T.
Si vous ne connaissez pas les codes de la dynamique de groupe, il est en effet difficile de mener une action collective sur le long terme. Ponctuellement peut-être, mais pas davantage. Laisser la place à chacun dans l’action, laisser à chacun le droit de s’exprimer, garantir à tous d’être entendu pour qu’une co-construction devienne possible, c’est un équilibre assez subtil à trouver, et cela exige certaines compétences.
Il y a des codes de base à respecter pour que cela fonctionne. Observez les groupes qui précisément dysfonctionnent: il suffit parfois d’un leader qui prend trop le dessus ou d’une couche trop épaisse d’incompréhension.
B. W.
Beaucoup estiment que l’on peut faire de l’action communautaire comme on fait de la prose, que la générosité suffit…
Y. T.
Je le répète : il y a des codes de base à respecter pour que cela fonctionne. Observez les groupes qui précisément dysfonctionnent: il suffit parfois d’un leader qui prend trop le dessus ou d’une couche trop épaisse d’incompréhension pour rendre difficile le fait d’engager des discussions efficaces et d’entretenir de bonnes relations avec les pouvoirs publics notamment.
B. W.
De quand date l’apparition de l’action communautaire dans la formation en travail social ?
Y. T.
Elle y a fait son entrée en Suisse à la fin des années 60, avec une première formation à disposition. Puis elle a presque complètement disparu des cursus, pour revenir en force dans les années 2000. La théoricienne du travail social Cristina De Robertis le dit très bien: cette forme d’intervention communautaire est à la fois ancienne et récente ; elle est toujours considérée comme novatrice et innovante, mais elle va et vient au gré des périodes.
B. W.
Quelles sont les conditions-cadres pour qu’une action communautaire existe ?
Y. T.
Le travailleur social Jack Rothman a décrit, dans les années 1970, un modèle qui a résisté à l’épreuve du temps, avec trois configurations. Avec la première, il y a l’émanation d’un collectif qui constate – dans son immeuble, son quartier, sa rue – l’existence d’un besoin ou d’un problème, comme la suppression d’une ligne de bus ou la disparition de commerces locaux. Dans ce cas, on est dans une configuration bottom up, et l’action peut aller jusqu’à la résolution de la problèmatique de manière autonome, même si elle dépend bien sûr des capacités d’autonomie de chacun dans le collectif.
B. W.
Quelle est la deuxième piste ?
Y. T.
Imaginons qu’un collectif existant, en pleine capacité, ait besoin d’un local ou d’une aide logistique comme peut le proposer une maison de quartier. Dans ce cas, une collaboration pourrait naître entre les deux entités de manière efficace, et nous ne serions alors ni dans du bottom up, ni dans du top down. Enfin, nous avons une troisième possibilité, celle du top down justement. Cette approche s’utilise beaucoup dans les projets urbanistiques : les autorités administratives ou politiques décident d’un plan à la suite d’un diagnostic posé sur tel ou tel quartier. Il s’agira alors de travailler avec la population locale impliquée. On peut aussi imaginer que le mouvement soit double, à savoir que le constat d’une institution ou du politique vienne rencontrer au même moment celui que pose la population. On parle alors de co-construction.
B. W.
La notion de « territoire » est un vrai enjeu pour l’action communautaire, dites-vous. Pourquoi ?
Y. T.
Dans des milieux urbains, le collectif peut s’appuyer sur des infrastructures qui l’aideront à faire émerger des projets communautaires, comme une maison de quartier ou une association telle que Pro Senectute. La ville – par exemple, l’exécutif de Lausanne et la mise à disposition de son budget participatif – peut aussi être le déclencheur d’actions communautaires. Dans les régions périurbaines, excentrées, il n’y a en revanche pas l’armada institutionnelle que l’on trouve en ville ; ce sont alors les mouvements associatifs ou des individus, qui s’organisent autour d’un besoin, qui vont agir. Je pense par exemple au nord de la Romandie, qui n’avait pas accès à des spectacles de danse contemporaine, ni de lieu dédié. Une association a été créée, puis un festival, qui a essaimé et qui a aujourd’hui été repris et est financé par les pouvoirs publics. Je peux citer aussi cette bénévole qui organise une fois tous les quinze jours un repas chez elle pour les aînés. Même si c’est organisé sous l’impulsion de Pro Senectute, il s’agit ici d’auto-organisation et, in fine, de création de lien social, de solidarité de proximité !
B. W.
Le modèle change-t-il beaucoup selon les générations ?
Y. T.
Mon expérience me fait dire que les nouvelles générations ne sont plus favorables aux engagements à long terme, ni à l’instauration d’institutions fortes, mais davantage adeptes d’une forme de « zapping ». C’est un autre modèle, sur lequel je n’ai pas de jugement, qui vient questionner les structures usuelles dotées d’un comité, d’un président, etc. Les réseaux sociaux permettent peut-être aussi plus de spontanéité dans la mise en place d’une action communautaire, mais cela exige un effort supplémentaire pour celles et ceux qui accompagnent. Je dirais que l’engagement à long terme est toujours possible, mais qu’il faut alors délivrer des résultats assez rapidement. Il faut aussi une certaine reconnaissance de l’engagement.
Oui, l’action communautaire n’a pas vraiment de frontière. Dans un immeuble, par exemple, vous allez inclure la gérance, les locataires ou les jardiniers ! Tous les secteurs peuvent en effet être concernés.
B. W.
Dans votre ouvrage, on voit que l’action communautaire peut toucher tous les domaines : la santé, l’urbanisme, le social…
Y. T.
Oui, l’action communautaire n’a pas vraiment de frontière. Dans un immeuble, par exemple, vous allez inclure la gérance, les locataires ou les jardiniers ! Tous les secteurs peuvent en effet être concernés. Certains d’entre eux sont favorisés, comme l’urbanisme quand on repense les villes de manière globale, avec la création de nouveaux espaces publics. Je pense par exemple à la ville de Delémont qui, au gré d’une recherche basée sur une démarche participative débutée dans les différentes maisons de retraite, a pu identifier un manque cruel de bancs publics pour les personnes âgées, ou alors, quand ceux-ci existaient, a pu constater leur mauvaise localisation. Cette recherche participative menée par un collectif a également permis d’observer que les pentes des trottoirs n’étaient pas adaptées aux personnes se déplaçant à l’aide d’un déambulateur ! Cette démarche a ainsi pu relever de manière concrète que l’autonomie et l’indépendance des personnes âgées sont souvent impactées par des barrières architecturales. Dans ce cas précis, comme ces remarques émanaient d’un groupe constitué en collectif, l’autorité a été immédiatement interpellée et la demande traitée. A l’échelle individuelle, en revanche, il ne se passe souvent rien lors d’une telle interpellation; il est alors indispensable de se mettre ensemble pour que cela bouge.
Tout le monde n’est pas égal devant l’action communautaire.
Pour autant, tout le monde y a sa place.
B. W.
Quel est le bénéfice de l’action communautaire pour l’individu lui-même ? On parle toujours de l’avantage de l’empowerment…
Y. T.
La question centrale est la suivante : la personne est-elle capable d’agir ? Et, si oui, d’agir avec les autres ? Certaines personnes oui, mais parfois c’est juste impossible ! Quand on vit trop d’embûches, cela empêche d’agir pour le bien commun. Quand on est en capacité d’agir ensemble, il y a un réel travail sur l’estime de soi à réaliser, sur le plaisir du partage, sur la notion du vivre-ensemble ; il y a une satisfaction aussi de mener un projet commun, jusqu’à ce que le collectif trouve du sens pour ceux qui le constituent, et que ce sens prenne le dessus.
B. W.
Le sens, c’est le mot-clé de toute action communautaire ?
Y. T.
Le sens dans l’action. Si on est capable d’agir et d’agir avec, on voit les choses différemment. Mais tout le monde n’est pas égal, je le répète, devant l’action communautaire. La question essentielle et première reste la capacité d’agir. Pour autant, tout le monde y a sa place. Le professionnel doit aller chercher tous les participants, celui qui garde toujours le silence aussi bien que celui qui parle spontanément.
L’action communautaire permet de remettre de l’huile dans les rouages et redonne du pouvoir aux représentés. Cela dynamise le fonctionnement de la démocratie de manière large et, à ce jour, on n’a pas de meilleur modèle…
B. W.
Et aujourd’hui, y a-t-il urgence à mener de telles actions communautaires ? Serait-ce même un devoir de société ?
Y. T.
La société doit prendre soin de tous ses membres, c’est le pilier de notre démocratie. Et oui, il y a urgence. Mais il ne faut pas détruire ce qui fonctionne: certains aujourd’hui sont très radicaux vis-à-vis du système et fustigent le fonctionnement représentatif, qui est la marque de notre démocratie. S’il est normal de monter aux barricades, il ne l’est pas moins que ce soit la majorité qui décide.
B. W.
Des pans entiers de notre société sont-ils oubliés ?
Y. T.
Nous avons un modèle démocratique qui fonctionne, même si l’écart se creuse de plus en plus entre les représentés et les représentants. L’action communautaire permet de remettre de l’huile dans les rouages et redonne du pouvoir aux représentés. Cela dynamise le fonctionnement de la démocratie de manière large et, à ce jour, on n’a pas de meilleur modèle… Il faut le dynamiser, le faire évoluer, et l’action communautaire y contribue.
En encourageant la participation et l’engagement citoyen à un niveau local, l’action communautaire « retricote » le lien social, le redynamise !
B. W.
De quelle manière ?
Y. T.
En encourageant la participation et l’engagement citoyen à un niveau local, l’action communautaire « retricote » le lien social, le redynamise ! En « réarrosant» le système, cela l’interroge aussi. C’est organique.
B. W.
Quel serait votre premier conseil pour lancer une action communautaire ?
Y. T.
Discuter avec son voisin pour voir si une problématique ou un besoin est partagé. Et trois ou quatre personnes suffisent. Ensuite, on réfléchit à ce qu’on peut faire, dans son jardin, devant la porte de son immeuble. L’action émane ainsi de la base. Si la maison de quartier est en face, c’est plus simple, bien sûr: un professionnel pourra vite venir en aide, collecter des informations, proposer des actions. On n’est pas tous égaux en la matière, je le répète : l’un aura le sens de l’organisation collective vrillé au corps, l’autre pas du tout. Mais autour de l’arbre à palabres, c’était exactement la même chose : on doit être ensemble pour réfléchir et trouver des solutions.
Si on ne peut pas rapidement jalonner l’engagement par des actions concrètes, on perd du sens, on n’y croit plus et cela amène un autre risque: l’essoufflement.
B. W.
Un groupe se constitue pour agir. Dès lors, quels sont les risques auxquels il s’expose ?
Y. T.
Le leader négatif, la prise de pouvoir ! Et si on ne peut pas rapidement jalonner l’engagement par des actions concrètes, on perd du sens, on n’y croit plus et cela amène un autre risque: l’essoufflement. Il faut avancer par étapes, et que ces étapes soient célébrées. On reconnaît ainsi le travail réalisé, cela redonne confiance et l’envie de poursuivre son engagement est décuplé !
B. W.
C’est tout le sens de l’appel à projets Solidarités locales qu’a lancé la Fondation Leenaards, si je comprends bien…
Y. T.
Oui, et c’est une excellente dynamique : les gens veulent monter des projets, mais n’en ont souvent pas les moyens, qu’ils trouveront peut-être grâce à ce soutien. Maisons de quartier, centres de jeunesse, homes pour personnes âgées : tout le monde est concerné! On peut enfin valoriser des projets et leur donner la visibilité qui permettra de mobiliser les gens et de lancer un véritable mouvement, par essence vertueux. En cela, l’action communautaire est aussi politique : en réfléchissant à la cité, on réfléchit au vivre-ensemble.
L’action communautaire est aussi politique : en réfléchissant à la cité, on réfléchit au vivre-ensemble.

Yuri Tironi a étudié le travail social à la HETSL, ainsi qu’aux Universités de Montréal et de Neuchâtel. Après une pratique en travail social de plusieurs années, il décide d’enseigner l’animation socioculturelle et l’action communautaire.
Au sein de la HETSL, il a été responsable de l’orientation animation socioculturelle de 2006 à 2019, avant de devenir vice-doyen responsable pédagogique de la filière travail social, dès2020.
Il a dirigé l’ouvrage L’action communautaire. Une praxis citoyenne et démocratique, publié en 2021. Corédigé par 19 auteur.trice.s, il relate notamment neuf expériences d’action communautaire s’inscrivant dans les différents cantons romands.